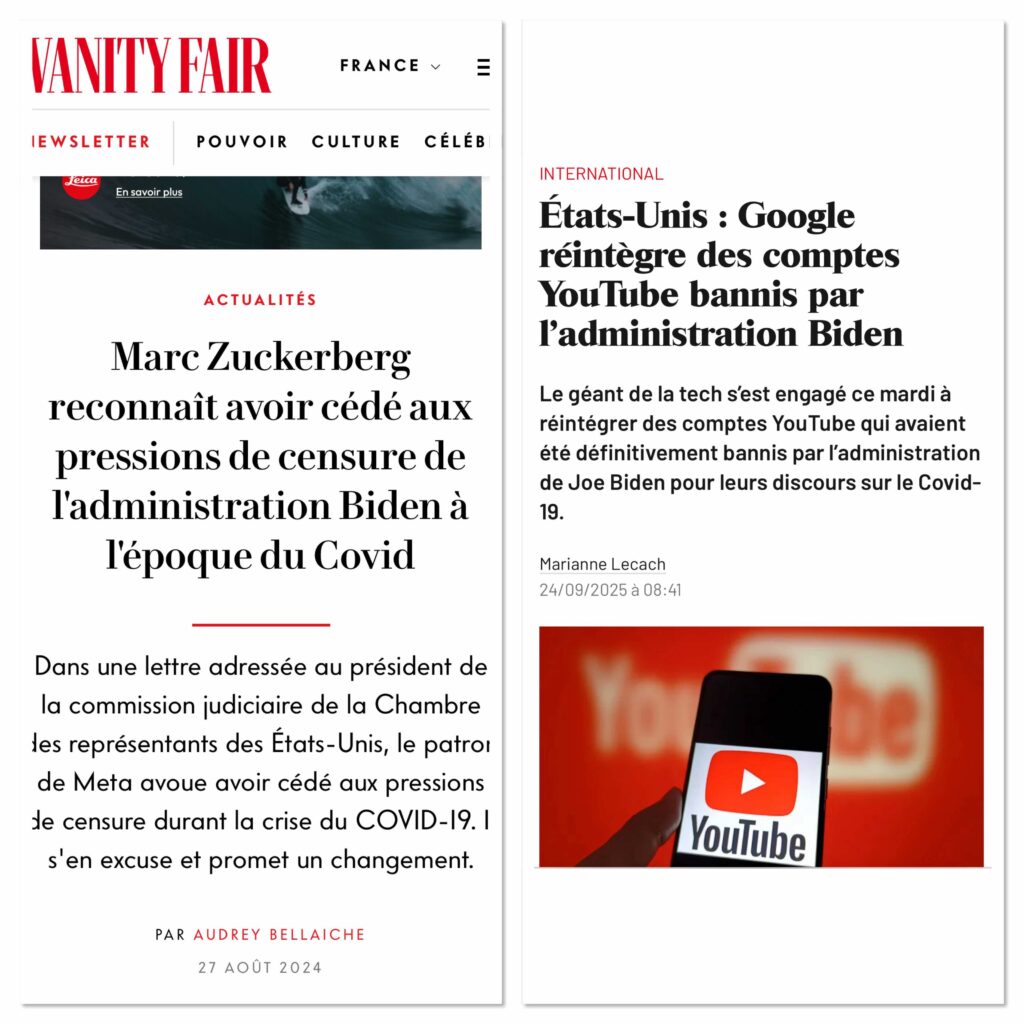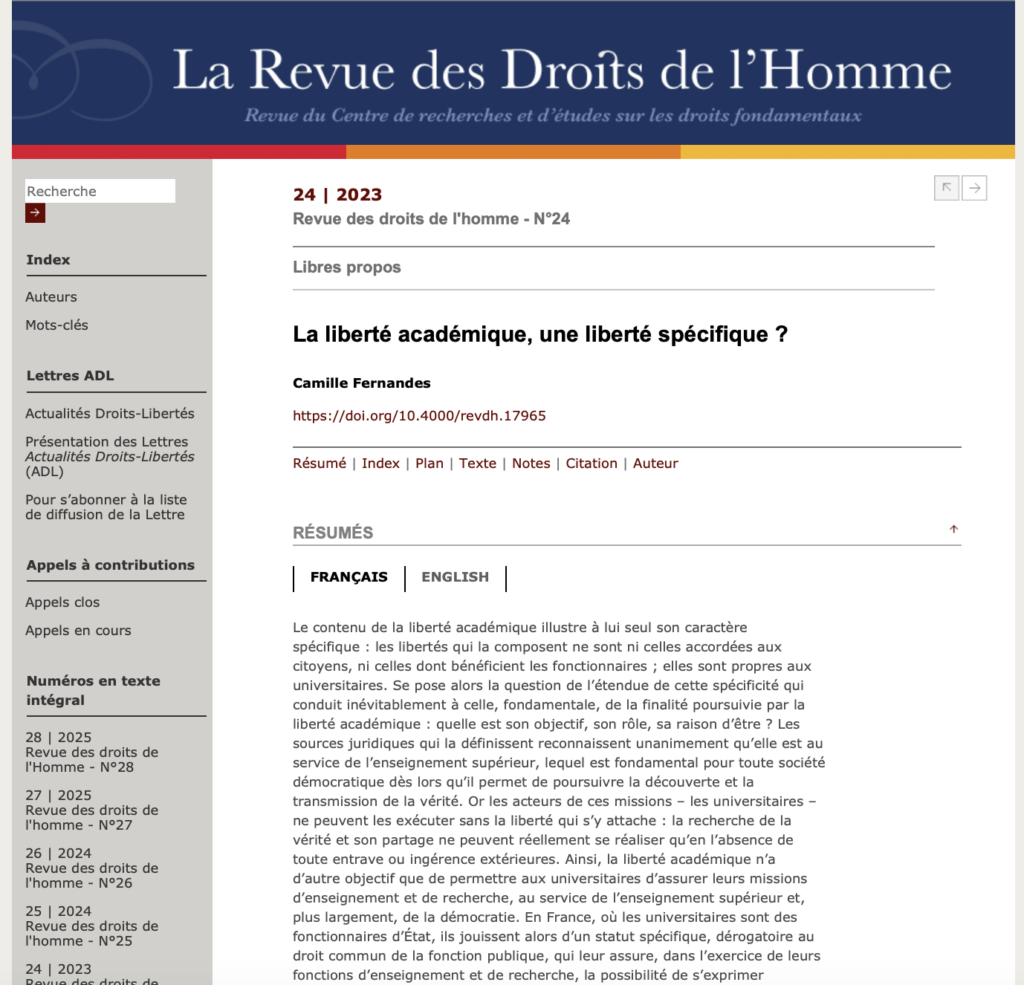Lutte contre les informations médicales erronées : un objectif plus complexe qu’il n’y paraît…

Distinguer (DES) et (MES)informations médicales
La « désinformation » désigne donc un acte de tromperie volontaire. L’auteur agit pour servir ses intérêts personnels, quitte à nuire à autrui.
Elle sous-entend une démarche mal-intentionnée délibérée :
- par volonté de nuisance vis-à-vis d’autrui,
- par poursuite d’objectifs autres que la seule connaissance scientifique.
Il apparaît donc incontestable de combattre la désinformation. Le crier haut et fort revient à affirmer avec audace… que l’eau, ça mouille et le feu, ça brûle !
La gestion de la « mésinformation » est un sujet plus délicat. La perspective d’une chasse à la « mésinformation » binaire et autoritaire, devrait alerter la population, plutôt qu’engendrer l’actuel enthousiasme général.
Evidemment, personne ne conteste que la quête de vérité fasse partie intégrante de la démarche scientifique. De ce point de vue, la « mésinformation » constitue indéniablement un élément parasite. Un aléa de la connaissance médicale.
Mais n’est-elle que cela ?
La CONTRADICTION: outil indispensable à la science
Qui aurait l’idée de condamner l’expression de désaccords entre spécialistes ? Quid des débats qui animent la communauté scientifique ?
Pourtant, lors de toute divergence d’opinions entre 2 savants, l’un des contradicteurs défend inévitablement une « mésinformation » !
VRAI hier, peut-être FAUX demain
« La vérité est fille du temps, et non de l’autorité »
Francis BACON
Le temps démasque inexorablement (et régulièrement) des « mésinformations ». Elles ne sont identifiées comme telles qu’à postériori. Chaque fois qu’un fait médical se trouve contredit, corrigé, complété, modifié, à l’aulne de nouvelles découvertes, le consensus établi perd son statut de vérité pour celui de « mésinformation ». L’histoire de la médecine rend compte de la multitude de « mésinformations » successives qui ont contribué à l’état actuel des connaissances. Souvent soutenues par d’illustres personnages de l’histoire, ces erreurs ont bel et bien participé à l’évolution des sciences médicales.
LE MANICHEISME: VERITABLE ENNEMI DU SAVOIR SCIENTIFIQUE
Le savoir scientifique se construit au terme d’un processus long. Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, l’expression sincère de « mésinformations » participe pleinement à l’élaboration du savoir. Il faut l’accepter et en rester conscients. De cet inévitable principe de réalité découle le fondement même des démarches de vérifications:
- par la nécessaire répétition des expérimentations,
- par la recherche d’une reproductibilité des résultats,
- par l’indispensable accumulation de preuves,
- jusqu’à atteindre la plus haute probabilité de se rapprocher du vrai.
Il n’en reste pas moins qu’affirmer avec certitude l’inexactitude d’une « mésinformation » n’est pas forcément aisé. L’erreur ne se confirme parfois qu’au terme d’un long processus d’acquisition du savoir.
Ce n’est qu’au prix de débats, de confrontations d’arguments discordants et par addition de données concordantes qu’un consensus tend à émerger. Dans la littérature scientifique, ce principe a conduit à élaborer les protocoles d’études à l’origine des fameuses « méta-analyses« . Les fact-checkers considèrent la « méta-analyse » comme le plus haut niveau de preuve. Soit. Pourtant, qui oserait attribuer un caractère infaillible à l’intégralité desdites « méta-analyses » publiées ? Pour mémoire, un article du blog avait pu mettre en lumière toutes les limites de la méta-analyse la plus faible de la littérature scientifique…
A QUI DONC CONFIER LE MINISTERE DE LA VERITE ?
Quelle autorité dispose d’une légitimité suffisante pour qualifier de « mésinformation » une opinion scientifique sinon les scientifiques eux-même ? Quand une « mésinformation » doit être contredite, les gouvernements et les médias devraient de facto être exempts d’une quelconque légitimité à le faire. Un homme politique n’a pas pour rôle de construire la science, ni de la défendre. La comprend-il seulement ? Le journaliste délivre l’information scientifique. Il l’explique parfois. Il n’appartient pas, à lui non plus, de juger du caractère valide d’une information exprimée par un scientifique.
A qui appartient le droit de déterminer à quel scientifique on accordera une respectabilité professionnelle, et auquel échouera le statut de paria de la communauté ? Aux regroupements de spécialistes ? Aux sociétés savantes ? A une supposée majorité émergente parmi les membres de la corporation ?
Mais alors, qui pour attester de la probité desdites sociétés savantes et de l’indépendance des membres qui la composent ? Qui pour comptabiliser les voix et déterminer le courant majoritaire avéré ?
Même les sacro-saints consensus peuvent différer d’un pays à l’autre. Cette réalité illustre que la notion de consensus demeure relative… Elle conserve une part de subjectivité car est influencée par différentes variables: l’influence culturelle, le poids des traditions, l’intervention du pouvoir politique en place, ou encore l’orientation des projecteurs médiatiques… Aussi, lorsque c’est l’uniformité de traitement d’une information par les médias qui détermine le consensus, chacun devrait conserver en mémoire la cartographie des propriétaires de groupes de presse (établie par Le Monde Diplomatique).
Le consensus est un argument politique, plus que scientifique…
L’histoire de l’humanité regorge d’instances respectables qui se chargèrent de faire taire conspirateurs et hérétiques afin de promouvoir la vérité: Inquisition, Politburo, Autodafés… les exemples sont légions… Alors, combattre les idées fausses: toujours un objectif vertueux ? une noble cause ? « Y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes… »
« MESINFORMATION »: LA MÊME RESTRICTION POUR TOUS ?
Reste à savoir comment traiter les « mésinformateurs ». Doit-on les considérer de facto comme déviants et infréquentables, ou comme les maillons nécessaires à tout processus de constitution de la connaissance ? Doivent-ils bénéficier de la liberté d’expression en toute impunité, ou doit-on les poursuivre jusqu’à les réduire au silence ?
Afin de déterminer la façon de combattre la « mésinformation », il faut prendre en considération la nature de la source qui l’exprime. Traiter indistinctement une « méprise supposée » d’où qu’elle provienne pourrait s’avérer simpliste et inapproprié.
Fake-news médicales diffusées par les politiques (cf exemples ci-dessus)
Comme nous avons pu le rappeler, les politiques peuvent asséner des informations erronées, tout en leur conférant une valeur de vérité. Quelle que soit l’intentionnalité sous-jacente, il semble donc peu prudent de confier à cette corporation le soin de fixer le « mètre étalon » de la vérité médicale. Si une « désinformation » est dénoncée, le politique doit répondre de ses actes devant les juridictions compétentes. S’il s’agit d’une « mésinformation » (en dehors de son champ strict d’exercice du pouvoir), on pourrait considérer qu’il doit bénéficier de la même indulgence que le reste des citoyens.
Infox délivrées par les médias (charte de Munich)
La question de la qualité de l’information délivrée par un média et de l’authenticité des sources est au coeur même de l’éthique journalistique.
La charte de Munich fixe les fondements du journalisme:
- Respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité.
- Défendre la liberté de l’information, du commentaire et de la critique.
- Publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent ; ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents.
- Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents.
- S’obliger à respecter la vie privée des personnes.
- Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte.
- Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement.
- S’interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d’une information.
- Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste ; n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs
- Refuser toute pression et n’accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction.
Transparence, pondération, probité, indépendance, auto-correction. Ces principes s’imposent théoriquement aux acteurs du 4ème pouvoir. Il appartient aux instances de contrôle des médias d’en faire appliquer les termes.
Mensonges partagés sur les réseaux sociaux
Où donc placer les réseaux sociaux dans la lutte contre la « désinformation »/ »mésinformation » ?
Vers l’interdiction de parler à tort et à travers
Les fact-checkers les fustigent autant qu’ils les investissent. Les pouvoirs publics ont dans leur viseur ce nouveau type de « café du commerce ». Tous alertent sur le danger que représenterait un espace où chacun s’exprime sans complexe, quelles que soient sa condition, son expertise et sa légitimité. Une partie de l’opinion publique semble partager cette inquiétude puisqu’il est de bon ton de dénoncer désormais « les spécialistes de facebook » ou autres « experts es-internet ». Les législateurs exhortent les réseaux sociaux à entamer un virage vertueux vers la protection des utilisateurs contre les fausses informations. Ces-derniers ont donc développé le principe de modération afin de filtrer les propos relayés sur leur plate-forme.
Pouvoir politique vs réseau social
L’espoir d’un arbitrage neutre et objectif n’a pas duré longtemps. « La raison du plus fort est toujours la meilleure ». Ainsi a-t-on pu voir le patron de facebook s’excuser d’avoir cédé aux pressions politiques exercées par l’administration Biden afin de museler les contradicteurs durant la crise COVID. L’intouchable Google vient d’initier le même méa-culpa à la stupéfaction générale. Heureusement, les gouvernements européens ont pu, eux aussi, protéger leurs citoyens de la propagande étrangère en interdisant le réseau social Rumble. Thierry Breton se montre particulièrement vigilant face au danger représenté par les chinois de Tik-Tok et le réseau X (ex-Twitter, propriété de l’indiscipliné Elon Musk).
Annihiler le biais des algorithmes… vraiment ?
La question des algorithmes qui favorisent la visibilité de certains types d’informations se pose indéniablement. Impossible pourtant de savoir dans quel sens l’algorithme agit pour taire une opinion ou pour promouvoir un point de vue. Ceux qui veulent combattre le biais généré par les propriétaires de réseaux sociaux semblent rapidement chercher à vouloir imposer leurs propres orientations idéologiques. Motivations financières ? Stratégies politiques ? Peut-être appartient-il aux usagers d’en rester seuls juges… et non à une quelconque autorité d’imposer ses propres manoeuvres correctives biaisées.
La meilleure défense restant l’attaque, le président français a appelé les Européens à «reprendre le contrôle de leur espace démocratique», accusant les géants du numérique d’alimenter la haine, la désinformation et la radicalisation politique (Le Figaro).
Décidément, réseaux sociaux et pouvoirs politiques entretiennent des liaisons dangereuses…
Les données erronées servies par l’industrie pharmaceutique

En matière d’évaluation des médicaments, qui aurait l’idée de se fier aux seules informations délivrées par ceux qui nous les vendent ?
S’il est question de nourrir des desseins autres que le bien commun, la visée lucrative de l’industrie pharmaceutique justifierait un soupçon de prudence chez « ceux qui l’écoutent » . A partir de 2021, les médecins de plateaux ont pourtant passé leur temps à vanter les qualités des vaccins à ARNm … en s’appuyant sur les seules études menées par les industriels. Mieux encore, l’Etat français a financé généreusement la campagne marketing desdites injections. Les ministres ont débordé d’enthousiasme, obligeant les firmes pharmaceutiques à pondérer eux-mêmes les propos dithyrambiques dénués de fondement scientifique. Du jamais vu.
En parallèle, on assiste depuis 5 ans à une curieuse tendance qui consiste à considérer comme complotistes ceux qui tentent de rappeler la vocation première des laboratoires pharmaceutiques: verser des dividendes aux actionnaires. Désormais, quiconque oserait sous-entendre l’existence d’un lobby de Big Pharma sera immédiatement décrédibilisé. Le complosophisme* est né.
Est-il seulement nécessaire de rappeler les condamnations prononcées chaque année à l’encontre des principaux acteurs du secteur pharmaceutique ?
Lorsque le politique base sa politique sanitaire sur les seules données délivrées par les industriels qui vendent le médicament, et sur les recommandations de cabinets de conseil appartenant aux mêmes actionnaires, difficile de lui déléguer le rôle de protéger les citoyens de la « désinformation ».
Restera à déterminer s’il s’agissait de simple incompétence ou de collusions d’intérêt teintées de corruption ? Le rasoir D’Hanlon démontrera alors peut-être ici ses limites…
Des propos contestables tenus par des spécialistes et autres scientifiques
Parmi les différentes catégories socio-professionnelles susceptibles de livrer des informations médicales, les scientifiques et les médecins devraient peut-être bénéficier d’un statut à part.
Pourtant…
Médecins
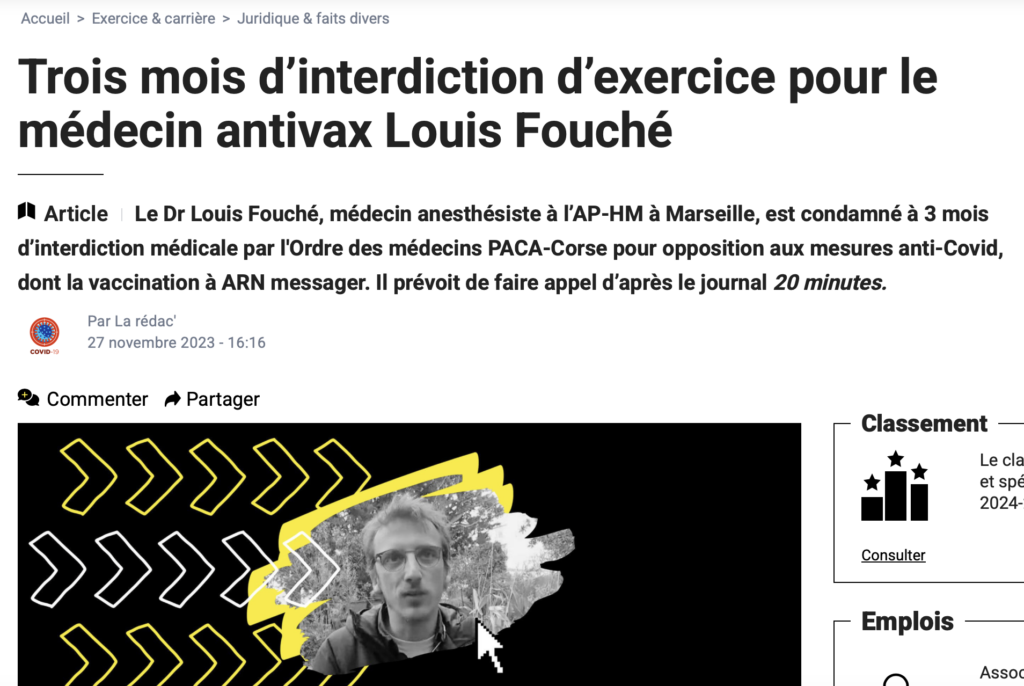
Un médecin doit délivrer librement les soins qui lui semblent adaptés à son patient. La décision thérapeutique s’inscrit dans le cadre d’une relation étroite, de confiance « soignant/soigné ». Le secret médical protège d’ailleurs celle-ci. Le prescripteur est censé recueillir le consentement éclairé du patient. Pour cela, il a l’obligation de lui fournir des explications claires, exhaustives, accessibles et sincères. Il délivre les soins « en son âme et conscience« . Il pourra ainsi rendre des comptes, devant ses instances disciplinaires, voire devant la justice, si son patient vient à se plaindre des traitements administrés.
Le droit de prescrire est soumis au titre de docteur en médecine. Il a comme contrepartie la responsabilité ordinale et pénale que les médecins endossent vis-à-vis de leurs patients. On aurait pu penser que le Conseil de l’Ordre des Médecins défendrait cette indispensable indépendance des professionnels de santé face au pouvoir politique. Certains événements sanitaires récents ont démontré le contraire…
Universitaires
Il existe, de même, une spécificité inhérente au statut de chercheurs et d’universitaires. Celle-ci repose sur leur rôle déterminant dans l’élaboration du savoir et la transmission des connaissances scientifiques. A ce titre, leurs libertés d’opinion et d’expression devraient être impérativement préservées.
Au travers de leur activité de recherche et de leurs publications internationales, ils contribuent directement à la construction du savoir médical. Bien qu’imparfait, le principe du peer review atteste du caractère « recevable » des productions qui seront ensuite publiées et donc partagées via les revues scientifiques. Nous avons pu évoquer précédemment la complexité inhérente à l’établissement d’une vérité scientifique. Il y a un danger évident à remettre en cause la protection des universitaires qui exprimeraient des opinions divergentes. La probité à priori attendue au sein du secteur publique de la recherche justifie d’une certaine immunité. Si des « mésinformations » sont inévitables, on ne peut en blâmer le chercheur. La « désinformation », elle, n’y a pas sa place. Dans le cas contraire, des lois existent et peuvent s’appliquer pour punir les éventuels cas de corruptions.
Conclusion
Depuis quelques années, la lutte contre l’obscurantisme semble adopter discrètement une nouvelle stratégie. Dans l’indifférence générale, on observe ainsi un insidieux glissement sémantique: l’encouragement au « savoir penser par soi-même », à l’accès libre à l’information et à l’exercice de l’esprit critique, laisse place à un nouvel angle d’attaque. Celui de la restriction, de la modération, de l’interdiction, et de la punition. Bien sûr, ces mesures autoritaires visent à protéger les citoyens candides des mensonges éhontés contre lesquels ils ne peuvent se défendre seuls.
Censure ? vous avez dit censure ?
Outre la possible dérive totalitaire qu’elle implique, cette vision simpliste dénote d’une ignorance totale de ce qu’est véritablement la science. Ceux qui ont tant invoqué l’esprit de Pasteur pour promouvoir la généralisation des injections à ARNm, devraient se souvenir que la France fut également le pays des lumières… Espérons que le trio d’experts « anti-désinformation médicale » conservera son indépendance vis-à-vis d’un quelconque pouvoir politique. Gageons que le duo Cymes-Veran mesurera la difficulté de la tâche à laquelle il prétend s’atteler. Défendront-ils l’esprit de Diderot et d’Alembert ? Ou agiront-ils comme agents d’un clergé exhortant à brûler l’Encyclopédie « sous peine d’excommunication » ? L’histoire de la médecine déterminera alors s’ils s’inscriront comme contributeurs aux avancées de la Connaissance, ou comme tristes collaborateurs aux pouvoirs politico-financiers…
Si les véritables partisans de la science apprécieront cette citation apocryphe de Voltaire:
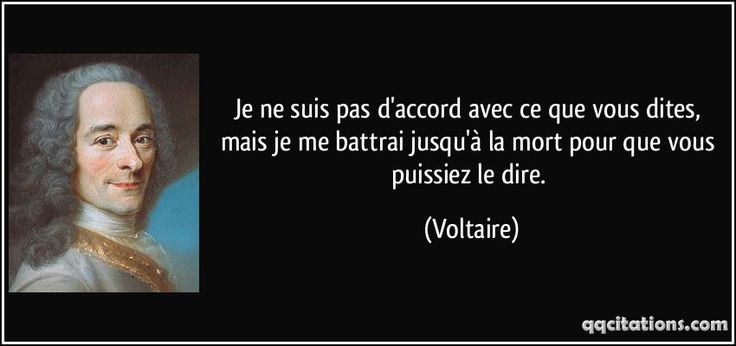
Les adeptes du scientisme, eux, s’obstineront à démontrer que Voltaire ne la jamais prononcée. C’est ce qui leur paraitra l’essentiel… « Quand le sage montre la lune… » CQFD
Index:
- Complosophisme: procédé discursif consistant à disqualifier un contradicteur en l’étiquetant « complostiste», afin d’écarter l’examen de ses arguments. On doit au philosophe Alexis Haupt ce néologisme.