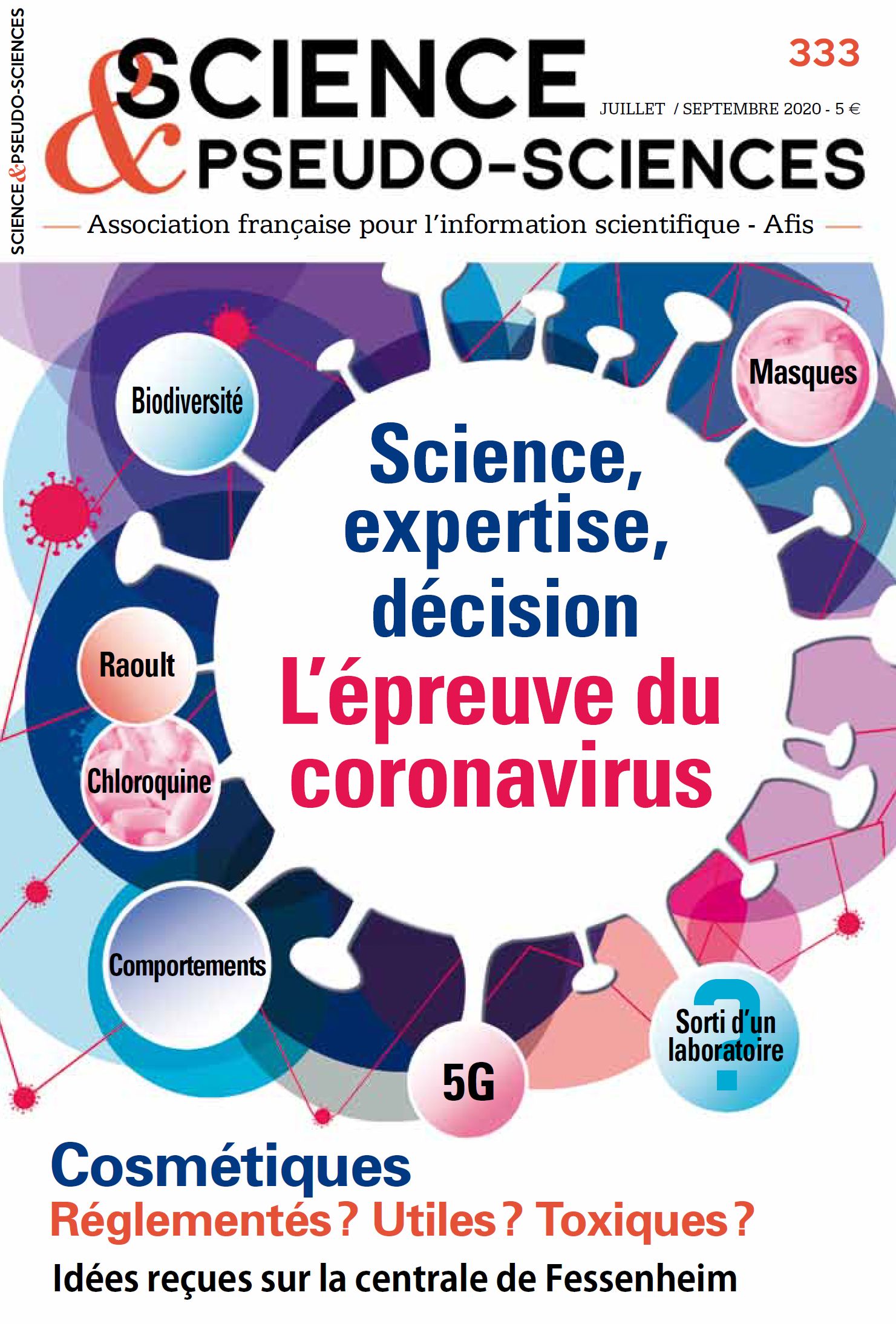
Le numéro 333 de la Revue Sciences et Pseudo-sciences vient de paraître pour la période Juillet/Septembre 2020. L’occasion pour l’AFIS (Association Française pour l’Information Scientifique) d’éclairer notre regard sur la tumultueuse actualité scientifique.
Comme en atteste la première de couverture, le thème de la pandémie de SARS-Cov2 y est logiquement privilégié : « Science, expertise, décision. L’épreuve du coronavirus. »
L’enjeu n’a peut-être jamais été aussi important pour le magazine scientifique. En effet, le sujet traité constitue la préoccupation majeure du moment. Ce, pour la planète entière. Il est indispensable de prendre le temps d’analyser les faits. De tirer les enseignements de cette étrange période. Bien souvent, la peur d’un ennemi inconnu est venue compromettre l’indispensable démarche hypothético-déductive. Plus que jamais, l’Art du doute, fondement de la connaissance scientifique, paraît avoir été particulièrement mise à mal. Aussi, il a été bien difficile de préciser un plan d’action face au risque sanitaire impérieux. Aucun consensus ne s’est véritablement imposé. En atteste les atermoiements des autorités sanitaires et la constitution d’une commission d’enquête par le Sénat pour tenter d’y voir clair, au-delà du brouhaha médiatico-politico-scientifique.
Alors, que retirer de cette situation inédite ?
Peut-être avant tout, que la connaissance scientifique ne peut se soustraire à l’acceptation de l’ignorance, comme préalable au savoir. Avoir conscience de ce qu’on ne sait pas encore permet de recueillir les indices avec un maximum d’objectivité.
Ensuite, qu’attiser son sens critique est essentiel quand il s’agît de savoir pondérer le crédit à accorder aux discours antagonistes qui furent tenus par les différents acteurs sanitaires, scientifiques, politiques, mais aussi médiatiques. Chacun s’est trouvé spectateur d’un nouveau type de guerre, celle de la communication. Une course à l’audimat et à la visibilité. Une opposition bi-partite entre médias traditionnels, dits officiels, et autres blogueurs – aux vidéos Youtube, d’une viralité telle qu’elles offrent parfois un écho supérieur à celui du bon vieux téléviseur.
Cette période restera probablement historique pour la vulgarisation scientifique.
Dans ce contexte sans précédent, l’Afis avait un rôle primordial à jouer. Un seul préalable nécessaire (conforme à l’esprit-même du scepticisme scientifique) : s’extraire de quelconque camp idéologique de principe. Plus que pour quiconque, on pouvait attendre de l’Afis qu’elle s’élève au-dessus du clivage primaire qui limite l’analyse à une simple distinction entre les sources d’informations dites-respectables et les diffusions sauvages de tribunes, rédigées par des anonymes aux points de vue indépendants. « Officiels face à clandestins »: L’Afis ne pouvait sombrer dans cette caricature.
La raison d’être de l’Afis était plus que jamais mise en exergue face à un afflux de données contradictoires d’interprétation délicate. Après une gestion, au mieux simpliste, sinon calamiteuse, de la page Facebook Les Amis de l’Afis – simples partages d’articles de presse généraliste, sans aucun reviewing de leurs contenus, participation à un lynchage sans nuance du personnage cible de Didier Raoult – tout restait possible.
Une « session de rattrapage » via la revue trimestrielle Science et pseudo-sciences était encore permise. Ladite page Facebook précisait d’ailleurs ne s’exprimer qu’au nom des « Amis l’Afis » et pas en celui de l’Afis, elle-même. Les publications n’y engageaient que les administrateurs du groupe, et non l’association. Un espoir était donc permis. La sagesse d’Henri Broch allait peut-être modérer ses pairs, voire les ramener à la raison.
Patatra.
La publication du dernier numéro de Sciences et pseudo-sciences enterre ces dernières lueurs d’espoir. La raison de ce naufrage est très vite identifiable.
La table des matières est immédiatement éloquente : plus de 50% du contenu des articles portant sur l’épidémie de Covid-19 est signé de la plume de Jean Paul Krivine. Certes rédacteur en chef de la revue, il semble être également l’administrateur de la page Facebook Les Amis de l’Afis. On se surprend à avoir été bien naïf de supposer que l’auteur puisse prendre de la hauteur, là où il avait échoué à se distinguer des postures caricaturales politiquement correctes sur le réseau social.
Le nombre étonnamment réduit des auteurs s’exprimant dans cette dernière édition de la revue trahit un cruel manque de pluralité, de différents angles d’analyse. Ils auraient été ici pourtant indispensables. En effet, il est difficilement justifiable de ne pas s’ouvrir au débat pour traiter d’un sujet si complexe et spécialisé. Il s’agit ici d’étudier un phénomène infectieux aigu. Les facteurs écologiques multiples qui l’influencent sont pour la plupart mal maîtrisés, de l’aveu même des experts. Il convient d’observer, décrire, évaluer l’articulation par laquelle responsables politiques et médecins sont parvenus à l’élaboration de stratégies sanitaires empiriques. Réponses à une situation de crise inattendue et donc sans protocole pré établi.
S’il y a un point commun à tous nos infectiologues nationaux, c’est qu’ils ont tous sous-estimé le risque que présentait ce nouvel agent infectieux pour notre pays.
Alors, que trouve-t’on dans le cœur de la revue ?
Un procès à charge contre ceux qui sont désignés par JPK comme d’obscures mystificateurs. Ceux qui sont coupables d’avoir délivré des fake-news, d’avoir usé d’ arguments fallacieux (sans qu’on puisse d’ailleurs saisir quelle en fut vraiment la motivation).
Sciences et pseudo-sciences nous livre ainsi une pensée unique… et univoque. La question est pourtant un peu plus complexe que de trancher sur l’existence de la mémoire de l’eau ou l’impact de la 5G sur les tumeurs cérébrales. Néanmoins, la messe est dite pour JPK: Raoult est condamné à rejoindre le rang des Benveniste, Seralini, Joyeux et autres naturopathes autoproclamés…
Une telle absence de nuance risque bien d’ailleurs d’apporter de l’eau au moulin de leurs disciples. Elle laisserait supposer que la science constitue une discipline binaire et que l’esprit critique se suffit d’une analyse simpliste. A défaut de compétence médicale, l’auteur aurait pu s’apercevoir, en rédigeant sa diatribe, qu’une vision manichéenne pouvait difficilement rendre compte d’un débat tellement complexe qu’il a divisé la communauté médicale dans son ensemble. L’humilité intellectuelle lui aurait alors permis de ne pas persévérer dans l’erreur. Vaines ont été les tentatives d’avertissements. De nombreux adhérents de l’Afis ne reconnaissaient plus la posture pondérée et apaisée initiale de leur mouvance rationaliste. JPK paraît être resté sourd aux démissions de certains responsables de comités régionaux, comme aux appels répétés à la nuance, formulés au travers de différents commentaires déposés sur le groupe Les Amis de l’Afis…
Une édition, orientée en sens unique, ayant clairement pour objectif de finir de démolir l’image du Pr Raoult. Ennemi désigné, pour qui JPK paraît avoir développé une étrange animosité, qui vire à l’obsession.
Libre à chacun d’être exaspéré et de critiquer l’assurance excessive du scientifique à l’allure mégalomane. En revanche, JPK décrédibilise l’intégralité de son discours en omettant de pointer du doigt les sophismes et autres biais d’interprétations qui ont prospérés durant cette trouble période dans les 2 camps. Raoult n’a pas eu le monopole des certitudes assénées avec désinvolture ! De nombreuses postures de principe et arguments fallacieux ont été brandis comme vérités par ses détracteurs durant cette crise sanitaire sans précédent.
Ce qui a été étonnamment négligé par l’Afis
Pas de commentaire portant sur les 2 articles rétractés après leurs publications (précipitées ?) par 2 des plus prestigieuses revues internationales (The Lancet, le NEJM) : un événement trop anecdotique et sans conséquence pour intéresser l’Afis et son rédacteur en chef ?
Aucune explication sur les biais d’analyses et d’interprétations statistiques qui compliquent la compréhension des chiffres bruts qui sont, aujourd’hui encore, diffusés chaque jour. Rien sur les taux de létalité fantasques et variés, sans cohérence entre les différents états, désormais en baisse constante avec l’évolution de l’épidémie. Rien sur la pondération à opérer lorsqu’on s’appuie sur le nombre de tests quotidiens positifs (puisque celui-ci est inexorablement corrélé au nombre de tests effectués) pour juger de l’activité virale. Rien sur l’intérêt de comparer la cinétique épidémique des pays de l’hémisphère Sud avec ce que l’on observe au Nord. Aucun décryptage de la pyramide des âges pour les décès par Covid-19. Aucune explication sur les mécanismes physiopathologiques qui aboutissent à l’orage cytokinique mortel, stade au delà duquel le virus n’est plus le problème (mais celui d’un emballement des réactions immunologiques) …
L’Afis aurait pourtant dû jouer un rôle déterminant pour accompagner ses adhérents dans l’analyse de ses données épidémiologiques qui furent (et sont encore) assénées par les médias. Rien sur la course au dernier chiffre à sensation fusse-t’il sans signification mais putaclic. C’est pourtant là, où une association de défense de l’Information Scientifique était attendue.
Si l’Afis, ne se distingue pas du « Decodex » du Monde et de la néo-censure organisée que Facebook paraît vouloir justifier par la défense de la (sa?) vérité, elle n’a plus aucune raison d’exister.
Pas de neutralité
Aucune symétrie dans la dénonciation des biais cognitifs, ni dans le repérage des sophismes, usés par les opposants à l’hydroxychloroquine (autant que chez ses adeptes). Les seconds voudraient probablement se contenter de trop maigres preuves pour en entériner l’effet thérapeutique. Les premiers semblent, eux, s’autoriser à requérir un niveau de certitude qui fait probablement défaut à l’intégralité de notre pharmacopée avant d’en légitimer la simple prescription…
Aucune prise de hauteur face à un « combat de chiffonniers » sur fond de réseaux sociaux, opposant finalement 2 idéologies contraires. L’une comme l’autre poursuit pourtant la même quête de certitudes sécurisantes, là où l’état des connaissances actuelles en manque cruellement. L’illusion de maîtrise est tellement séduisante.
Des erreurs passées inaperçues
Le nombre des arguments fallacieux qui visèrent à ridiculiser le protocole thérapeutique probabiliste de l’IHU– avant que son inefficacité ne soit plus avérée que son efficacité – est impressionnant. Surprenante toxicité, de découverte bien tardive pour une molécule accessible en libre accès jusqu’à il y a peu, et prescrite larga manu dans le monde entier. Des pseudo-essais respectables effectués à des stades avancés de la maladie (là où la charge virale n’est plus le problème et l’HCQ inutile). Des essais randomisés en double aveugle qui n’ont jamais pu aboutir à une quelconque conclusion (faute de patients à inclure et en raison d’une méthodologie adapté à l’étude de phénomènes prolongés mais pas à une période épidémique aiguë !). L’évaluation de posologies 4 fois supérieures à celles préconisées par la plupart des pays employant le dérivé de quinine (COVERAGE). De nombreux essais portant sur une monothérapie, là où les pharmacologues étudient l’effet synergique de l’association à l’azithromycine pour en argumenter la pertinence. Des protocoles d’évaluation prétendument effectués dans les règles de l’Art mais dont on interrompt un des bras avant même le terme de l’étude – en raison de « l’évidente absence d’efficacité » d’une des molécules testées (l’HCQ). A-t’on déjà vu ça ??
Un manque d’humilité quasi-raoultien
Aucune reconnaissance pour les équipes médicales internationales extra-marseillaises (Italiennes, Arabes, Japonaises...) qui continuèrent la recherche sur l’hydroxychloroquine + azithromycine (probablement sous emprise du gourou provençal ?). Un silence ou des commentaires cyniques qui laisseraient entendre que ces scientifiques sont des simples d’esprit, prêts à perdre inutilement leur temps pour un résultat déjà connu de tous, et surtout des intellectuels occidentaux (à qui on ne la fait pas).
Pas de mise en garde quant aux mêmes (pires ?) incertitudes qui pèsent sur l’efficacité du prometteur et lucratif Remdesivir®, ni sur sa dangerosité bien supérieure à l’hydroxychloroquine, ni sur l’absence de recul sur son usage, ni sur son coût financier conséquent. Pas un mot sur l’étrange indulgence dont bénéficie l’indigence de ses résultats préliminaires. On est bien loin du haro qui s’abattit sur le maudit Plaquénil®.
Un manque total de pédagogie quant il s’agirait de traiter du problème inhérent au financement de la recherche pharmacologique par les industries à visée lucrative. Aucune explication sur le système d’obsolescence des brevets, qui conduit à l’oubli délibéré de molécules génériquées en dépit des nombreux potentiels effets thérapeutiques, de découvertes empiriques tardives.
Une absence d’écho au discours d’Agnes Buzyn, devant les sénateurs, lorsqu’elle explique avoir modifié les modalités de prescription de l’hydroxychloroquine, suite à une « alerte de l’ANSES,… heu,… de l’Agence du médicament (?) », dont [elle] n’a pas vérifier le contenu en détail. Classement comme substance vénéneuse surtout parce que « moins on prend de médicament mieux on se porte »(sic).
Aucune réserve sur les déclarations d’une professeure d’infectiologie sur BFM.TV, dès le début de l’épidémie (le 21 Mars au 20h00): « inutile de tester, car quelqu’un de négatif peut être positif le lendemain » (sic).
L’indulgence zététique à géométrie variable.
Les méthodes utilisées par Didier Raoult pour communiquer, publier ses travaux de recherche et soigner ses patients ont été jugées contestables, sinon charlatanesques. Les adeptes de la zététique ont été prompts à les dénoncer sans équivoque.
A contrario, impossible de trouver quelconque condamnation (ne serait-ce qu’en défense de la déontologie scientifique) des menaces proférées envers l’iconoclaste infectiologue par un de ses pairs. Un appel téléphonique, à visée d’intimidation, qui s’est avéré provenir d’une ligne du CHU de Nantes et dont l’auteur serait le Professeur Raffi, médecin-universitaire en infectiologie. Champion de France des sommes reçus par le laboratoire Gilead, promoteur du Remdesivir®. Ce type de comportement mettrait-il moins en péril les valeurs fondamentales de la médecine ? La probité scientifique de cet individu serait-elle mieux préservée par ce type d’attitude, que s’il était l’auteur des propos outranciers tenus (à visage découvert) par le patron de l’IHU de Marseille ?
Etrange focalisation
JPK se cantonne à pourfendre ce qu’il juge avoir été les contre-vérités exprimées par le médecin-chercheur Marseillais. Pensez donc ! un indice H qui ferait saliver tout aspirant scientifique inaccompli ! Que ses co-détenus n’aient eu cesse que de vouloir se mesurer à Mike Tyson, lorsqu’il fut en prison, traduit indéniablement la nature humaine. Don’t act. En revanche, le rédacteur en chef de Sciences et pseudo-sciences portait bien d’autres responsabilités que ces simples taulards. « Qui croire, que croire ? » se targue-t’il de développer lors de conférences-enseignements, visant à délivrer la bonne parole. Le conférencier doit probablement posséder une sacrée légitimité pour disserter sur cette épineuse question. Il omet pourtant actuellement (volontairement ?) de relever les différentes sources d’informations qui ont mis à mal l’information scientifique. Comme si Marseilles était devenue subitement le seule et unique temple (de ce qu’il considère être) des fakes news. Cocorico ! même les âneries de Trump et Bolsonaro prennent source dans l’emprise de notre gourou sur ces stars du populisme mondial.
Ne surtout pas rendre à César…
De même, « silence-radio » sur certaines réalités épidémiologiques que Didier Raoult a été le premier à révéler via les vidéos hebdomadaires de l’IHU (et probablement au sein du conseil scientifique sans y être entendu):
- la nécessité de tester autant que possible, et dès que possible, les patients pour isoler les positifs (« confinement ciblé » décrit comme éventuel recours à une seconde vague, par le Président Macron, lors de son discours du 14 Juillet),
- les conflits d’intérêt chez des experts du conseil scientifique, pour les producteurs de nouvelles molécules pressenties pour agir contre le Covid-19
- la lourdeur administrative d’accréditations contre-productives, derrière laquelle de nombreux CHU se sont retranchés pour justifier de leur incapacité à tester de façon massive la population (pendant que d’autres pays y procédaient sans difficulté),
- la distinction à effectuer entre la phase virale et la phase auto-immune du COVID-19 pour bien en comprendre les stratégies thérapeutiques à envisager,
- le caractère asymptomatique/paucisymptomatique des jeunes enfants dont le faible portage viral les confirme de plus en plus comme des piètres contaminants,
- l’encouragement à regarder le déroulement des événements en Océanie pour évaluer au mieux les risques à venir d’une récurrence l’hiver prochain, dans l’hémisphère Nord.
Comment prétendre défendre l’information scientifique avec un tel « cherry picking » ?
Un appel aux « vraies références » médicales
JPK pense verrouiller son parti pris en s’appuyant sur des figures d’autorité (argument tant contesté à Raoult, lorsqu’il explique à raison être le plus reconnu des infectiologues français). Il loue ainsi la liste (non exhaustive) des prestigieux signataires d’une tribune intitulée « La médecine ne relève pas d’un coup de poker » (d’un coup de poker, non… mais de l’évaluation d’une balance bénéfice/risque, peut-être, non ?)
La moindre des choses aurait été de la mettre en perspective avec celle qui fut signée par des spécialistes non moins prestigieux pour exiger la liberté de prescription de l’hydroxychloroquine par les médecins dont c’est le métier. La restriction de la liberté de prescription pour les médecins n’a pas fait beaucoup de bruit parmi les défenseur de l’intégrité scientifique. Personne pour défendre la prescription des traitements par nos médecins en « leur âme et conscience » et à la « lumière des connaissances acquises par la science au moment des soins » et selon leur évaluation de la balance bénéfice/risque. N’est-ce pas assez préoccupant pour que l’Afis s’y intéresse dans les pages de son magazine ?
Oraison funèbre de l’esprit critique
De mémoire de lecteur jamais un numéro de Science et pseudo sciences n’a offert une telle indigence scientifique. Jamais un sujet ne fut traité d’une façon aussi orientée. Une propagande reste une propagande quelle que soit la nature de l’idéologie qu’elle pense combattre.
La défense de la science ou de la zetetique semble avoir été reléguée au second rang. Tous les moyens seraient donc permis pour dénoncer, ce qui vient d’être désigné comme pseudo-sciences par l’élite intellectuelle du moment. Certes, le travail de rédaction en est grandement simplifié. Mais la démarche scientifique en est réduite à néant.
Choisirunmédecin pensait pourtant pouvoir s’appuyer sur cette précieuse association (l’Afis) pour promouvoir et vulgariser l’Evidence Based Medicine et la médecine rationnelle. L’ambition était mesurée. Faire mieux que les sites « Santé » qui prospèrent sur la toile en priorisant le potentiel putaclic des articles à leur pertinence. Notre renoncement à une source de références fondamentales comme l’était l’Afis, semble résulter de la concentration des pouvoirs par un rédacteur en chef devenu omnipotent, probablement intelligent et bien intentionné, mais à l’absence de flexibilité cognitive manifeste. Un naufrage provoqué par un défaut de méta-condition:. « Serait-ce diantre possible que je me fourvoie dans certaines de mes certitudes ? »
JPK est donc orateur lors de conférences publiques sur un thème passionnant : « Qui croire, que croire ? ». Que JPK soit conférencier à l’autorité autoproclamé sur ce sujet tellement épineux pourrait laisser craindre à l’avènement d’un nouveau gourou de la bien-pensance. Raoult détrôné par celui qui souhaitait tant le démasquer ?
Méa-culpa:
On pourra reprocher à cet article qu’il use des mêmes armes que celles dont il conteste la légitimité à la rédaction de la revue Sciences et pseudo-sciences. Il s’agissait ici simplement de représenter le contre-pied à la posture sans concession de l’Afis. Cette précieuse association dont l’essence même était de sensibiliser les lecteurs aux pièges des biais cognitifs, vient de tomber dans l’un d’eux : celui du « saut à la conclusion » engendré par la pensée unique partisane..
Ce texte n’engage que son auteur : David Esfandi, psychiatre-addictologue, ex-adhérent à l’Afis, néo-complotiste malgré lui.
ERRATUM: Yann Kindo vient de m’informer que Jean Paul Krivine n’est pas gestionnaire de la page Facebook Les amis de l’Afis. Il me précise ainsi qu’il est loin d’être l’unique décisionnaire de la ligne éditoriale concernant le Covid-19 suivie par l’Afis et son organe de presse. Si cela ne change pas le fond du problème soulevé dans le texte ci-dessu, il semble néanmoins justifier des sincères excuses à JPK pour lui avoir fait endosser l’intégrale responsabilité du naufrage de l’esprit critique à l’Afis. Il s’agirait donc d’un « collège de rédacteurs et administrateurs » de l’Afis qui auraient déterminer l’absence de pondération et nuance dans l’analyse d’un événement sanitaire trop récent et complexe pour jouir d’un quelconque consensus scientifique. Don’t act. Mais cette réalité n’est-elle pas encore plus préoccupante pour l’avenir de l’association ?
